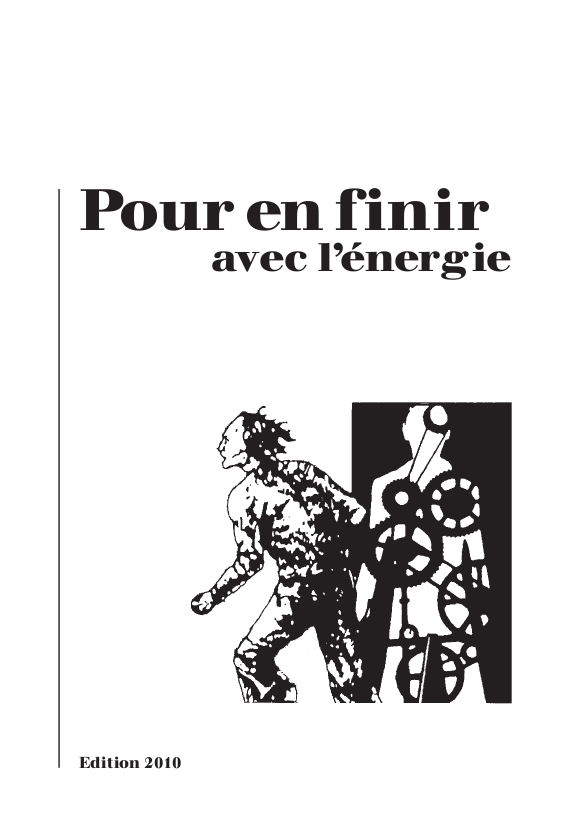Accueil > Articles > Sciences, technologies mortiféres et industrie > Pour en finir avec l’énergie
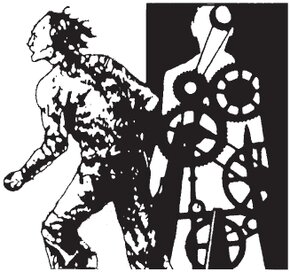
Pour en finir avec l’énergie
mercredi 19 juin 2019
« De même que, dans les sciences de la nature, chaque question est subordonnée à la tâche de comprendre la totalité de la nature, chaque progrès de la technologie est au service du but général : accroître la capacité de l’humanité à transformer la nature. La valeur de ce but est aussi peu contestable que la valeur de la connaissance de la nature pour la science. Les deux buts confluent dans la formule désormais banale, sans laquelle il n’y aurait pas de progrès de la science : le savoir est le pouvoir.  »
Werner Heisenberg, Père fondateur de la physique atomique.
L’énergie, terme autrefois réservé aux scientifiques, est désormais l’un des plus vulgarisés au monde. Mais, avec la banalisation, le sens originel a disparu, au point que l’énergie sert au quotidien à désigner les choses les plus diverses et les plus antagoniques : de la vitalité déployée par tel ou tel individu à la puissance accumulée par les redoutables instruments de la société contemporaine, sans compter l’utilisation teintée de mysticisme dans laquelle elle est quelque peu synonyme d’esprit du monde. En démocratie, les citoyens sont bien entendu « libres  » de dire n’importe quoi, d’instrumentaliser le langage, en particulier le langage de la science de l’énergie. Mais ce qui me gêne ici, ce n’est pas tant le terme que ce qu’il recouvre : l’acceptation de l’activité domesticatrice du capital.
***
Bien que l’énergie soit devenue quelque chose de familier, elle n’en reste pas moins mystérieuse. Pour l’athéisme, elle est, en conformité avec la philosophie de la nature issue de la Renaissance, la substance de l’univers, le concept toujours semblable à lui-même, au fond vide de contenu, dont les formes sont les forces de la nature. Elle a pris la place de la divinité sur l’autel de la science et il est aussi sacrilège de poser la question de l’origine de l’énergie que celle de l’origine de Dieu. Mais, dans les annales de l’histoire du monde profane, il n’en est pas ainsi. L’histoire de l’énergie est en réalité liée à celle du travail. La société, dans la mesure où elle repose sur le travail, a besoin de force motrice pour mettre en oeuvre les instruments nécessaires à la domestication de la nature. Pendant longtemps, le muscle est demeuré la source principale de force motrice, les autres ne jouaient que des rôles annexes, et le mouvement qu’il fournissait était limité à la traction d’engins rudimentaires. A l’aube de l’ère industrielle, en Europe, la bourgeoisie hérita des sources de force motrice antédiluviennes. Pour asseoir et développer la puissance titanesque qui lui était nécessaire afin d’industrialiser le monde, elle ne pouvait en rester là . En particulier, le muscle lui paraissait trop débile. De plus, il avait tendance à avoir des réactions imprévisibles et à faire preuve de réticences, en premier lieu le muscle humain. Le feu allait être mis à contribution. Le feu est l’une des plus belles manifestations de la puissance créatrice de la nature, puissance parfois redoutable et destructrice. Le feu transforme les êtres et les objets, en modifie les propriétés et, bien entendu, brà »le avec des dégagements de chaleur et de lumière. Pendant longtemps, l’humanité a été fascinée par le feu, l’a vénéré et craint et, peu à peu, a appris à l’utiliser, à le conserver, puis à en faire, pas toujours en fonction d’objectifs très nobles et très drôles. Les détenteurs du pouvoir, à l’origine les castes sacerdotales, ont toujours cherché à apprivoiser le feu et à l’employer pour domestiquer la nature, la nature humaine en particulier, pour impressionner et soumettre les individus qui n’acceptaient pas les règles et les lois de la communauté hiérarchique, de l’Etat. La menace de l’anéantissement de l’humanité par le feu divin prenait corps dans les autodafés des hérétiques. La guerre du feu ne date pas d’hier.
La bourgeoisie a très bien su utiliser, et utilise toujours, la terreur qu’inspire la capacité destructrice du feu, en particulier celle des armes à feu. Mais du savoir-faire sans âge qui accompagnait les fêtes et les mythes dédiés au feu, elle fit table rase ou, de façon plus précise, le considéra comme négligeable. Elle le réduisit à presque rien, le refoula et définit le principe fondamental de la « science du feu  » qui devait permettre de guider la fabrication des moteurs qui lui étaient indispensables : la chaleur devint source de force motrice. Le terme de force motrice est d’ailleurs synonyme de travail pour la « science du feu  », la thermodynamique. Pour elle, l’essentiel est que la combustion dégage de la chaleur, que, canalisée, la chaleur fait varier les propriétés dynamiques des corps, en particulier des gaz, et qu’elle peut donc mettre en mouvement les moteurs qui restent encore à la base de l’industrialisation du monde : les moteurs thermodynamiques.
***
Dans l’imaginaire populaire, le fonctionnement des moteurs thermodynamiques est ramené à quelque chose de très familier et de très banal. Le gros bon sens n’y voit rien de plus que la généralisation des propriétés des antiques foyers domestiques, utilisés pour satisfaire les besoins quotidiens élémentaires. Pour lui, l’énergie est à la base du progrès et du bien-être de l’humanité, l’absence d’énergie conduit à retomber de la civilisation dans la barbarie. L’analogie est cependant très superficielle. Elle gomme les spécificités des moteurs thermodynamiques, de leurs modes de génération et de propagation de la chaleur. Il ne suffit pas de capter et d’émettre de la chaleur pour les faire fonctionner. A supposer même que leur étanchéité soit presque parfaite, il ne peut en résulter que la conservation de la chaleur, du moins en première approximation. Les moteurs doivent encore être capables de la propager pour fournir de la force motrice. Or, elle circule dans le sens de la chute de température. Lorsque la température des moteurs est homogène, ils restent inertes.
Les premiers concepteurs furent d’abord éblouis par le mode de fonctionnement des moteurs thermodynamiques : au cours de la conversion de chaleur en travail, la valeur totale des deux termes demeurait constante. Mais ils prirent vite conscience de l’incontournable réalité. Jamais l’intégralité de la chaleur ne peut être transformée en force motrice puisque il est indispensable d’en absorber pour qu’elle soit propagée. De plus, le flux de chaleur tend à homogénéiser la température et, par suite, à anéantir la condition qui est à la base même du fonctionnement des moteurs. Le rendement thermodynamique tend à décroître, à la limite il devient nul, même lorsque l’étanchéité est proche de la perfection, même lorsqu’il n’y a plus de pertes sensibles dues à des imperfections de fabrication. Les vices de forme éliminés pour l’essentiel, les moteurs modelés à l’image du moteur idéal autant qu’il est possible de le faire, il reste toujours le vice de contenu, qui constitue l’ultime barrière à la conversion de chaleur en travail. Il est nécessaire de rétablir l’ensemble des conditions initiales indispensables au fonctionnement, en priorité la différence de température, sinon les moteurs perdent de la puissance pour en fin de compte stopper. Ils sont cycliques ou ils ne sont rien. Dès lors, la guerre contre la tendance à la baisse du rendement est devenue la hantise permanente des concepteurs des moteurs thermodynamiques. La force motrice dépend de la différence de température. Il faut donc au moins en freiner le nivellement. Pour cela, les moteurs dévorent sans retour concevable le combustible qui crée de la chaleur, dont la fraction inconvertible est renvoyée dans le milieu, aussi bien au cours de la consommation du combustible que de la production du travail. D’où l’apparition, avec l’industrialisation, du phénomène, inconnu jusqu’alors à pareille échelle, de la pollution thermique. Car le milieu est incapable d’encaisser sans dommages les chocs thermiques cumulatifs occasionnés par les variations chaotiques et répétées de température.
La bourgeoisie ne peut se satisfaire du simple maintien de la puissance existante. L’accumulation de capital nécessite l’accumulation et le déchaînement de la puissance motrice. Il lui faut donc sans cesse multiplier et perfectionner les moteurs thermodynamiques, en premier lieu les combustibles et les modes de combustion, pour élever au maximum la température initiale par rapport à la température ambiante. En dernière analyse, les moteurs n’ont pas tant besoin de foyers, au sens habituel du terme, que de fournaises de plus en plus performantes, la dernière en date utilisée à grande échelle est la fournaise nucléaire, pour accroître la puissance disponible et convertible en travail. De la course à la puissance, nous connaissons désormais trop bien les conséquences inévitables : le saccage et la stérilisation de la nature, réduite à la sinistre condition de réservoir de combustibles et de dépotoir des ordures toxiques générées par les modes de combustion, sans que l’on puisse même envisager la simple restitution de ce qui a été façonné et dilapidé pour le capital.
***
Le besoin d’affirmer et d’accroître la puissance domesticatrice du capital est l’aiguillon du progrès de la science et de la technologie. Il conduit à multiplier et à diversifier les innovations, en particulier dans le domaine décisif de la puissance motrice. Depuis longtemps, l’énergie n’est plus assimilable à la seule énergie thermique, à la chaleur. Les systèmes thermodynamiques ont proliféré, aussi divers que les types d’utilisation auxquels ils sont destinés. Ils sont devenus indispensables au fonctionnement de la société, dans la production comme dans la consommation. Il n’est pas exagéré de dire que, dans les Etats civilisés, ils font partie du mode de vie au point que les gens n’envisagent même plus de survivre sans eux.
Mais, en dépit du degré de sophistication qu’ils ont atteint, ils relèvent toujours du même principe de base défini à l’époque héroïque des premiers moteurs thermodynamique. La notion d’énergie généralise celle de chaleur. Elle symbolise la capacité des systèmes thermodynamiques à fournir de la force motrice. La force motrice elle-même est devenue de l’énergie. Par suite, la conservation de l’énergie, à l’origine liée à la conversion de chaleur en force motrice, englobe l’ensemble des conversions des énergies les unes dans les autres, de même que la tendance de l’énergie à la dégradation et au nivellement, l’entropie, englobe la tendance à la perte de rendement. Lorsque les systèmes sont isolés, l’énergie perd peu à peu la faculté de fournir du travail. Les conversions deviennent de plus en plus difficiles à réaliser au fil du temps et de moins en moins opérationnelles. A la limite, il ne peut plus y en avoir. L’entropie symbolise leur irréversibilité.
Le concept d’irréversibilité traduit le dilemme de la thermodynamique. L’évolution des systèmes est toujours orientée dans le même sens et tend à détruire les propriétés de l’énergie. En principe, elle est conservée en quantité, mais pas en qualité. Les diverses formes d’énergies, même les plus rentables, sont confrontées au phénomène de la dégradation, de leur transformation en chaleur à basse température, proche de celle du milieu. Pour surmonter l’implacable contradiction, les constructeurs des systèmes n’ont pas d’autre choix que de pomper de la puissance dans le milieu, ce qui d’ailleurs n’annule pas l’entropie mais au mieux la freine. La conséquence de leur mode de fonctionnement est claire : ils ne restituent jamais ce qu’ils vampirisent et dévorent, la vitalité de la nature. Ils la dégradent et la stérilisent toujours en qualité et quantité.
***
Le seul langage que les sciences connaissent est celui du calcul. Il n’est de science que chiffrée. La thermodynamique n’y échappe pas. Pour elle, le rôle de l’énergie est décisif car il permet de formaliser dans le langage des mathématiques ce que sont les systèmes thermodynamiques. En effet, pour mesurer des entités variables de même espèce, elle a besoin de définir l’étalon de mesure qui, en bonne logique, doit être considéré comme invariable. L’énergie satisfait grosso modo à la condition. Rien d’étonnant qu’elle constitue ici le fétiche par excellence comme la monnaie l’est pour l’économie politique depuis des siècles. L’énergie est l’or de la science, l’étalon de mesure de l’ensemble des processus thermodynamiques. Dire qu’elle est conservée revient à dire que la science a enfin défini l’équivalent général des processus en question. Il permet d’analyser leurs évolutions, symbolisées par l’entropie, d’agir sur eux et donc de choisir ceux qui sont les plus rentables pour la mise en valeur du capital.
L’entropie fait la liaison entre la science et la gestion du capital investi dans l’énergie. En effet, le calcul de l’entropie permet de déterminer ce qu’il peut espérer en tirer en termes de rendement. L’énergie est peut-être conservée mais toutes les sources énergétiques et tous les états énergétiques ne lui sont pas utiles au même titre. Les diverses énergies sont donc classées de façon très hiérarchique, des plus nobles aux plus vulgaires, non pas en fonction des besoins de la vie mais des nécessités de la société. Le rendement thermodynamique est l’un des facteurs essentiels de la détermination du rendement du capital, au sens de la mise en valeur. La conservation de l’énergie justifie le pillage des ressources sous prétexte qu’elles sont inépuisables, tandis que l’évolution de l’entropie permet de sélectionner celles qui, en particulier en fonction de l’état de la technologie, peuvent être utilisées avec profit.
Mais comme l’entropie mesure aussi leur degré de dégradation, derrière le mythe de l’abondance apparaît à intervalles plus ou moins réguliers le spectre de la pénurie d’énergie. Les crises de l’énergie, qui ne datent pas d’hier, sont l’une des manifestations typiques des limites que rencontre le capital. Pour lui, la nature est le monde de la contrainte, qui fait obstacle au libre développement de l’accumulation mais la stérilisation qu’il lui fait subir épuise les sources d’énergie successives qui sont de moins en moins rentables. Les difficultés sont toujours surmontées de façon momentanée par la fuite en avant, en particulier par l’innovation dans le domaine de l’énergie et par la valorisation de sources d’énergie jusqu’alors laissées en friche.
***
Les thermodynamiciens tournent en ridicule les recherches naïves des alchimistes d’antan. Ces derniers espéraient découvrir la substance miraculeuse capable de réaliser la transmutation des choses en or. Naïveté qui extrapolait à partir de la fonction de l’or d’être l’équivalent général des marchandises. Mais l’énergie est la pierre philosophale des thermodynamiciens ! Le sinistre professeur Laborit, vulgarisateur de la bioénergétique, affirme sans rire : « La vie, y compris la vie de la société, n’est rien d’autre que de l’énergie... La nature étant la source inépuisable d’énergie, il n’y a pas lieu de croire que, en l’absence de cataclysmes planétaires, la vie puisse cesser sur le globe et, en particulier, la vie humaine, tant qu’elle est capable de libérer de l’énergie.  » Le monde de l’énergie prend des allures d’Eldorado ! Les énergéticiens croient dur comme fer avoir découvert en lui la force motrice de l’univers, derrière laquelle il n’y a que le vide, l’ultime, l’universelle, l’unique et l’indestructible essence de tous les phénomènes de la nature et qui, par suite, constitue la corne d’abondance du capital dans laquelle il peut puiser à volonté sans souci des conséquences destructrices. Le mythe de la libération de l’énergie est des plus tenaces. En dernière analyse, la source de l’énergie est bien entendu dans la nature. Mais elle n’en recèle pas pour autant. La société ne libère pas l’énergie, elle la crée par le biais des systèmes et des réseaux d’instruments façonnés pour la générer, l’accumuler, la convertir et la transmettre. L’énergie est du capital.
En dépit de leur orgueil de mandarins et de leur prétention à croire que leurs activités sont bien plus nobles que celles, sordides, des communs des mortels, les thermodynamiciens n’ignorent pas la connexion entre science et technologie et à quoi elles servent : leurs instruments de laboratoire sont les modélisations des instruments utilisés à grande échelle par la société et, en retour, ils permettent d’en guider la fabrication et le perfectionnement. Mais, comme le reste des scientifiques, ils fétichisent leurs recherches, leurs cogitations et leurs instruments. Ils figent leurs activités, imaginent qu’elles planent bien au-dessus de la société et de l’histoire du monde, qu’elles les outrepassent pour devenir en quelque sorte les guides de la connaissance de la nature. En cela, ils révèlent qu’ils partagent la même idéologie que l’ensemble des membres du monde à l’envers. Pour le capital, les activités de domestication qui lui sont propres, y compris le travail, sont par excellence les activités génériques des humains. Éternelles, perfectibles et indépassables, elles sont les seules qui puissent leur convenir pour échapper aux horreurs de la sauvagerie, pour bénéficier des bienfaits de la civilisation, bref pour humaniser la totalité de la nature. L’idéologie de la supériorité de l’humanité sur le reste de la nature, de la civilisation sur la prétendue sauvagerie, est celle de la hiérarchie, de l’Etat. Elle sanctionne la domination de la société sur la nature, la nature humaine y compris.
La science prétend que la seule soif de connaissance l’anime. Mais elle est partie intégrante du monde de la hiérarchie et de la domination. Loin d’être guidée par le désir bien humain de comprendre et d’apprécier la nature, elle l’instrumentalise et la fonctionnalise à l’image de la société. Le père fondateur de la science expérimentale, vers la fin de la Renaissance, sir Francis Bacon, avait au moins le mérite d’annoncer la couleur : « La philosophie de la nature réclame la préparation de la chose appropriée et c’est pourquoi nous nous penchons fort peu sur l’histoire de la nature libre et déliée dans l’œuvre et le cours spontané qui lui sont propres. Nous nous préoccupons de l’histoire de la nature contrainte et tourmentée, telle qu’elle est quand l’effort et l’art des mortels l’arrachent à l’état propre, la pressent et la façonnent. Nous n’avons cure de l’orgueil et du prestige de la chose et la nature apparaît plus à travers les tourments et les fers de l’art que dans la liberté propre.  » Le socle sur lequel repose la science est la domestication. La conclusion de Francis Bacon, credo des scientifiques, est inévitable : elle est « le savoir qui doit coïncider avec le pouvoir  ».
***
La notion d’énergie fut, pendant longtemps, associée aux entités que la science appelle les choses par opposition aux êtres. Les êtres relevaient de la compétence de la biologie. La biologie, à l’origine, était imprégnée de vitalisme, doctrine d’après laquelle les phénomènes de la vie sont irréductibles aux phénomènes étudiés par les autres sciences, la thermodynamique en particulier, et manifestent l’existence de la « force vitale  », force cosmique quelque peu transcendantale, qui les anime et les structure. Elle finit par abandonner le vitalisme, non pas parce qu’il puait le mysticisme mais parce qu’il n’était pas opérationnel et qu’il était presque impossible de le traduire dans le langage des mathématiciens. Elle reprit de la thermodynamique la notion d’énergie et posa la base de la « science de la vie  » : « La vie est pour l’essentiel faite de phénomènes énergétiques particuliers.  » Mais avec l’énergie, elle acceptait l’entropie qui représentait la tendance à la désagrégation, à la déliquescence, à la déstructuration et à l’arrêt des systèmes thermodynamiques. La biologie reconnaissait néanmoins dans la vie la faculté de constituer, de façon spontanée, des structures de plus en plus sophistiquées, sièges de phénomènes de croissance, de division, de multiplication, etc., bref d’évolutions qui, d’après elle, conduisaient de l’être le plus simple au plus complexe : l’humain. La vie lui paraissait antinomique avec l’entropie. La contradiction fut refoulée, comme d’habitude, par l’invention de concepts qui ne remettaient pas en cause l’énergie. La vie fut définie comme tendance à réduire l’entropie, dans le langage des biologistes, la néguentropie.
Les biologistes aiment railler les premiers dynamiciens qui, à l’aube de l’ère industrielle, assimilaient les êtres à des horloges, à l’image des premiers automates. Les choses ont en effet beaucoup progressé depuis ! Désormais, pour la biologie, les êtres sont des automates sophistiqués, des cyborgs, des biocyborgs même : « La vie est l’ensemble des fonctions qui résistent à la décomposition et à la mort.  » La formule est de Bichat, l’un des plus célèbres créateurs de la physiologie à l’époque de la révolution industrielle. A partir de telles prémisses, il n’y a plus à s’étonner du caractère mortifère de la biologie qui donne des frissons dans le dos à quiconque sait ce que vivre veut dire ! Ici, il n’y a plus place pour la sensibilité, l’affection, l’imagination, la réflexion et bien d’autres facultés de la vie qu’il est impossible de définir car elles ne sont sans doute pas encore apparues. La notion de créativité, au plein sens du terme, implique qu’il y aura encore des créations, des disparitions, des transformations imprévues dans le monde humain et non humain, que l’ensemble des évolutions, des mutations et des régressions n’est pas donné d’avance et prévisible. Le mythe de l’éternel retour des phénomènes analogues extrapole à partir de la conservation de l’énergie.
Pour la biologie contemporaine, le monde de la vie est celui de la science des systèmes. Elle instrumentalise et fonctionnalise l’animé comme les prétendues sciences de la nature le font avec l’inanimé. De la naissance à la mort, la vie des individus et des espèces est interprétée en termes de fonctionnement, de dysfonctionnement et d’arrêt des systèmes, commandés par les flux et les transformations de l’énergie. La vie n’est que la lutte perdue d’avance contre la désagrégation et la mort, et la vitalité n’est que l’une des fonctions soumises à la morbidité. Pour Laborit, « la notion de néguentropie dans les phénomènes de la vie n’est concevable qu’en fonction de l’entropie première, celle du milieu d’où émerge la vie  ». La vie telle que l’imagine la biologie n’est pas la propriété primordiale de la nature. Elle en est détachée et est placée au-dessus d’elle à l’image de la société. Elle ne peut exister qu’au détriment du milieu qui l’entoure. Véritable vampire, elle puise force et fécondité dans le reste de la nature qu’elle saigne et assassine. Nous connaissons bien la vie que la biologie nous décrit : la guerre quotidienne de tous contre tous et de chacun contre lui-même qui est à la base de la survie du capital.
La réduction des êtres à l’état de systèmes et de leurs facultés à l’état de fonctions ne va pas sans conséquences. Elle en fait quelque chose de standardisable et de manipulable. De la biologie à la biotechnologie, le pas est vite franchi et les paroles hypocrites et moralisatrices sur la « bioéthique  » n’y changent rien. La biologie favorise la mise au service du capital de processus et de propriétés de la vie qui lui échappaient encore quelque peu. En particulier, elle rend possible la création des combustibles et des modes de combustion inédits sous l’appellation non contrôlée de bioénergies.
***
En l’espace de quelques siècles à peine, le capital moderne a ravagé le monde avec les systèmes à énergie bien plus que les anciens despotismes ne l’avaient fait pendant des millénaires. La dernière guerre mondiale a donné le coup de fouet à la science de l’énergie, en premier lieu à celle de l’énergie atomique. Les mouvements environnementalistes furent à l’origine des réactions de méfiance, puis d’indignation, contre le potentiel destructeur des énergies mises en Å“uvre au cours des dernières décennies, en particulier l’énergie nucléaire à usage militaire et civil. Elle a été dénoncée et combattue à juste titre, y compris dans des pays comme la France qui, au lendemain de la « crise du pétrole  », ont fait le forcing sur le nucléaire et instauré le monopole d’Etat sur la production et la consommation d’électricité d’origine nucléaire.
Mais la diabolisation de l’électronucléaire par les environnementalistes a en fin de compte révélé leur incompréhension du fond du problème. En tant que générateur de désastres, le nucléaire n’était pas le seul à être en cause. Il constituait plutôt l’aboutissement momentané de la tendance du capital à renouveler les énergies primaires lorsqu’il y a crise de l’énergie. Dire cela ne signifie pas nier le caractère particulièrement dévastateur du nucléaire, mais le replacer dans le contexte de l’histoire récente. En dernière analyse, ce n’est pas seulement l’énergie nucléaire mais, à travers elle, l’énergie elle-même qu’il aurait fallu remettre en question. Des environnementalistes peu nombreux commencèrent à faire cette démarche et à critiquer le mode de vie, en particulier dans les mégapoles, qui nécessitait de produire et de consommer de telles énergies destructrices.
Mais la plupart des contestataires ne poussèrent pas aussi loin en terre inconnue. Tandis que les leaders devenaient des politiciens à part entière, gestionnaires de l’Etat et conseillers en environnement, leurs troupes continuèrent à revendiquer que l’Etat économise de l’énergie et favorise la mise en Å“uvre des prétendues énergies douces et propres à usage domestique. Ils ne comprenaient même pas que l’énergie est du capital et donc que le but premier de la création d’énergie est de l’accumuler. Les délires du genre surgénérateur nucléaire, au plutonium et au sodium, auraient dà » les en convaincre. Les plus radicaux tentèrent parfois d’explorer en modèle réduit les possibilités fournies par les forces motrices d’origine solaire, éolienne, hydraulique, végétale, tellurique, etc. Ils tentèrent ainsi d’être quelque peu autonomes au quotidien envers le monopole d’Etat en manière d’énergie, basé sur l’électronucléaire, et de limiter les ravages. La chose était compréhensible et même parfois indispensable. Mais il n’en reste pas moins vrai que l’incapacité générale à comprendre l’origine et la fonction de l’énergie est l’une des causes essentielles de la faillite de l’environnementalisme, de la dégénérescence en groupes de pression, Greenpeace en offre le meilleur exemple, et de la récupération officielle à laquelle nous assistons aujourd’hui.
L’environnementalisme est désormais enlisé dans le réformisme le plus vulgaire. Il continue à prendre appui sur l’indignation qu’inspirent les gestionnaires officiels de l’énergie, mais la contestation, même violente, ne sert plus que d’exutoire et de caution radicale pour accéder à la notoriété, marchepied pour participer à la gestion de l’Etat lui-même. Les associations comme Greenpeace, en dépit de leurs gesticulations spectaculaires, sont dominées par des cénacles de conseillers en environnement qui disposent de centres de recherche financés par des fonds publics et privés. Rien d’étonnant dans la mesure où l’écologie, en tant que science de l’environnement, a depuis longtemps adopté les principes de la science de l’énergie. Leur credo est le recyclage des poubelles du capital, l’économie d’énergie et la promotion de l’énergie propre et douce, laquelle est supposée réduire la pollution, en particulier l’effet de serre.
Il y a belle lurette qu’ils ont renoncé au bricolage et au recyclage, parfois utiles, à usage individuel. Leurs lieux communs sur les forces de la nature et leurs analogies superficielles entre la gestion des maisons et celle de la maison Terre cachent leur extrême soumission aux nécessités de la production et de la consommation de masse du capital. Ils ne parlent pas de savoir-faire mais de technologie sophistiquée. Même la conversion de la lumière en électricité, en l’occurrence la lumière du soleil, a désormais leurs faveurs. L’effet photovoltaïque est plus connu du public par le biais des instruments qui en sont le siège : les cellules solaires. Longtemps décriées comme lubies, elles sont aujourd’hui à la mode. Les arguments des apologistes du procédé, Greenpeace au premier chef, ne manquent pas : caractère à première vue inépuisable de la source, le soleil, facilité d’utilisation et d’adaptation aux conditions locales, proximité des lieux d’habitation et de travail, donc réduction des pertes dues à la distribution, etc. Ils oublient évidemment quelques détails. D’abord, la fabrication des cellules solaires relève de la technologie de pointe, basée sur la manipulation du silicium, au même titre que la fabrication des puces électroniques. Elle est l’une des plus polluantes du monde : elle aggrave l’effet de serre ! La chose est de notoriété publique et il faut la naïveté, pour ne pas dire l’hypocrisie, des conseillers scientifiques de Greenpeace pour l’oublier dans leurs propositions pour le réduire ! De plus, avec le progrès enregistré récemment par la biotechnologie, il devient même possible de substituer en partie la chlorophylle au silicium. Traitée, dopée et bombardée par des rayonnements ultraviolets sélectionnés par des filtres solaires, elle crée de l’électricité. Les environnementalistes y voient le modèle de l’énergie douce et propre de demain, la bioénergie, disponible à volonté et inépuisable puisque la chlorophylle est présente dans l’ensemble du règne végétal !
Nous connaissons bien désormais le chant des sirènes de l’énergie. Des arguments publicitaires analogues ont déjà été employés pour chaque innovation technologique en matière d’énergie, y compris pour le nucléaire. Progrès, propreté, facilité, fiabilité, indépendance des Etats envers le marché mondial de l’énergie, etc. Le seul argument nouveau, susceptible de séduire les naïfs, est que l’énergie diversifiée et décentralisée favorise l’indépendance de chacun envers le réseau hypercentralisé de distribution dont la France reste le modèle. Mais la réduction de pareille dépendance n’implique pas l’absence de dépendance en général. Bien au contraire. Elle est facilitée par l’avancée de la technologie en matière d’énergie, qui commence à pouvoir fabriquer des centrales domestiques de la même manière que des ordinateurs domestiques. Les instruments énergétiques les plus divers envahissent tous les domaines de la vie quotidienne. La simplicité de leur utilisation masque la complexité de leur conception et de leur fabrication. Elle donne l’illusion aux utilisateurs d’en avoir la maîtrise au moment même où ceux-ci leur imposent leur mode de fonctionnement, de surcroît de plus en plus automatisé. La proximité des instruments laisse croire aux consommateurs qu’ils sont proches, en quelque sorte, de leurs concepteurs, constructeurs et producteurs. Mais elle les dispense en réalité de réfléchir de façon critique sur leur mode de fonctionnement. La thermodynamique, comme n’importe quelle science, est ainsi magnifiée par les nécessités de la survie quotidienne. A première vue, elle n’est plus cantonnée dans de mystérieux laboratoires : elle est omniprésente dans la société. Mais le savoir qui est à l’origine de la fabrication des instruments, lui, n’est pas partagé. Il reste le monopole de la hiérarchie. Ici comme ailleurs, la soumission aux impératifs du capital et du pouvoir d’Etat est d’autant plus solide qu’elle est voilée par le dogme de la souveraineté des citoyens. De la liberté, elle ne prend que l’apparence.
***
Pendant encore longtemps, l’énergie atomique continuera à nous empoisonner la vie, en particulier en France à cause du fanatisme des nucléocrates du CEA. L’atome est leur démon familier et, dans leur aveuglement, ils ne voient pas de salut en dehors de lui. Mais de là à parer les énergies de proximité de vertus imaginaires !
D’ailleurs, la dénonciation des dangers liés à l’utilisation frénétique des énergies traditionnelles, en particulier de l’énergie nucléaire, fait de plus en plus partie du discours officiel, même en France, patrie du monopole d’Etat sur l’atome. Tchernobyl est passé par là . Les mêmes gestionnaires qui décrétaient hier le désastre impossible en admettent aujourd’hui la possibilité. Bien entendu pour le faire accepter plus facilement par des populations parfois moins crédules, à défaut d’être vraiment radicalement hostiles au dieu radioactif du CEA. Dans le technodiscours, il y a d’ailleurs désormais bien plus que de la démagogie. L’économie d’énergie et le recyclage des poisons que l’énergie génère sont devenus rentables grâce à l’innovation technologique. Mais basés sur les mêmes principes de fonctionnement que le reste, ils participent à l’empoisonnement général. De plus, les gestionnaires de l’énergie sont bien placés pour savoir que l’actuel mode hypercentralisé de génération et de distribution d’énergie électronucléaire est gros de contradictions difficiles à résoudre. Il permet de contrôler, voire de militariser, la population du pays et de lui imposer des prix de monopole en l’absence de concurrence. Mais il favorise trop le lobby nucléariste, l’hypertrophie du secteur nucléaire au détriment de tous les autres, l’hypercentralisation, la lourdeur et la rigidité du réseau de distribution, qui manque de souplesse pour répondre aux besoins du marché en constante évolution. De plus, les pertes en chaleur, lors du transport de l’électricité par ligne, sont énormes.
Les décideurs des autres pays occidentaux, plus malins, ont compris depuis longtemps les limites des réseaux d’énergie hypercentralisés. Les scientifiques du World-watch Institute, qui font fonction de conseillers du prince, dans les lobbies proches de la Maison blanche et de l’Agence mondiale de l’énergie, affirment : « Fondé sur l’utilisation efficace et décentralisée des ressources renouvelables et locales, le système mondial de l’énergie peut être moins vulnérable aux bouleversements de n’importe quel ordre et plus orienté vers les principes du marché et de la démocratie. Dans le domaine de la gestion de l’énergie, il prend appui sur le besoin des citoyens d’être responsables de leur vie quotidienne.  » Parfait ! La diversité, la biodiversité même, dans le domaine de l’énergie est en train de devenir le credo du capital. Il n’y a pas besoin d’être prophète pour deviner ce que sera demain le secteur de l’énergie. Le progrès technologique qui commence à poindre permettra de vendre sur le marché les centrales de proximité les plus diverses : les biocentrales, les éolicentrales, les photocentrales, les géocentrales, etc. Les utilisateurs, producteurs et consommateurs, pourront aller parfois les acheter dans les supermarchés de l’énergie comme ils le font déjà pour leurs générateurs de poche. Et, en cas de catastrophe, les intoxiqués n’auront plus que leurs yeux pour pleurer. Ils les veulent, leurs énergies et leurs centrales à domicile. Ils les auront. Les gestionnaires de l’énergie, eux, pourront jouer les Ponce Pilate encore bien plus qu’ils ne le font déjà aujourd’hui.
Voilà qui devrait donner matière à réflexion à ceux qui, bien qu’hostiles aux asso-ciations environnementalistes officielles, n’en continuent pas moins à faire de l’expérimentation des énergies de proximité, les prétendues énergies douces et propres, la panacée universelle. Là où elles commencent à être utilisées à grande échelle, hors de France, elles deviennent vite aussi dangereuses que les énergies habituelles, du charbon à l’uranium, bien que de façon différente. En particulier, l’absence de radiations d’origine nucléaire n’empêche pas celles d’origine thermique, électrique, magnétique, etc. qui stérilisent et massacrent le sol, le sous-sol, l’air, l’eau, le végétal et l’animal.
***
Dans les Etats les plus avancés, les gens sont perdus sans énergie et, ailleurs à travers le monde, le même phénomène est en cours de réalisation. Ils sont tellement dépossédés par leur activité au service du capital des actes élémentaires indispensables à la vie, faire du feu par exemple, que les gestes millénaires n’existent plus pour eux qu’à titre d’objets pétrifiés dans les musées, sans âme et sans vie, qu’ils contemplent sans rien y comprendre. Ils sont encore moins capables d’en imaginer par eux-mêmes. Par suite, l’affirmation selon laquelle ils vivraient sans doute beaucoup mieux à condition d’en finir avec l’énergie provoque, en règle générale, la perplexité, la stupeur, voire la raillerie, même de la part d’individus qui ont beaucoup de choses à reprocher au monde contemporain.
Le problème n’est pas non plus que les individus renoncent aux gestes et aux activités transformatrices qui leur sont propres pour arrêter le désastre comme le proposent les environnementalistes misanthropes et quelque peu panthéistes. Pour eux, l’humanité ne peut que détruire, constitue, en principe, l’espèce nuisible par excellence et les espèces non humaines devraient en quelque sorte lui déclarer la guerre pour l’anéantir. Leur réaction est compréhensible mais, mine de rien, très moralisatrice et favorise l’abandon du combat contre le capital. A moins de souhaiter la disparition totale de l’humanité, la simple présence d’humains implique qu’ils modifient leur environnement pour vivre. Transformer n’est pas en soi saccager, bien que les transformations qu’ils peuvent effectuer ne soient pas toujours du goà »t des non-humains. La vie, la vie humaine en particulier, implique aussi la décomposition et la destruction, parfois douloureuse et violente. Elle n’est pas le paradis harmonieux tel que l’imaginent les environnementalistes sentimentaux. Elle connaît la symbiose mais aussi la prédation, et les relations entre les individus et les espèces n’excluent pas les conflits, parfois meurtriers.
De plus, lorsque l’environnementalisme appelle l’ensemble des individus à contrôler la gestion de l’énergie pour éviter les catastrophes, bref à être coresponsables, non seulement il moralise mais encore il leur demande de devenir omniscients, de connaître et de prévoir la totalité de l’évolution passée, présente et future de la nature. Mais à supposer même qu’ils éradiquent le capital, ils n’en maîtriseront pas pour autant toutes les conséquences de leurs actes transformateurs dans la nature. La connaissance n’est pas donnée a priori. Elle évolue et progresse par voie de contradictions, de tâtonnements, de confrontations, de mises en œuvre, de remises en cause et de critiques. De plus, l’humanité n’a pas le monopole de la créativité. La nature non humaine est elle aussi féconde. Les êtres qui la peuplent possèdent leurs propres façons d’être évolutives, donc agissent et réagissent à nos sollicitations de façon parfois imprévisible. Pour paraphraser le philosophe de la nature Hegel, pas plus que la liberté, la connaissance n’est la nécessité comprise pour la bonne raison qu’il n’y a pas de nécessité de fer dans la nature. L’association avec la nature non humaine, rêve sans âge de l’humain, n’est pas préétablie et donnée a priori. Elle est à conquérir sans cesse.
Le maintien en vie de chaque individu implique qu’il rejette dans le milieu les poi- sons qu’il distille lui-même bien que, en règle générale, les toxines dangereuses, voire mortelles, pour l’espèce qui les fabrique soient pour d’autres espèces et pour d’autres règnes des facteurs bénéfiques de régénération. Le reproche essentiel que nous pouvons faire au monde de l’énergie est qu’il génère, lui, des processus de destructions irréversibles, du moins à l’échelle de l’histoire connue de l’humanité, qui vampirisent et stérilisent la nature sans compensation concevable. Transformer avec le souci de la restitution est le minimum pour stopper le massacre, pour que les humains commencent à construire le monde qui leur soit propre, sans être synonyme de propriété et de domination sur les non-humains. Ici, il n’y a pas de solution miraculeuse, unique et globale. L’individualisation et la diversification ne sont pas des facultés exclusivement humaines. Elles existent ailleurs dans la nature qui nous entoure, quoique parfois de façon peu perceptible pour nous. Les activités transformatrices doivent tenir compte de l’évolution, de la diversité et des façons d’être des milieux et des espèces sous peine de ressembler beaucoup à ce que nous connaissons trop bien.
***
La liquidation du monde de l’énergie n’est pas l’affaire de l’individu isolé, pas même de poignées d’individus associés. Elle est impensable sans la rupture profonde de la masse des êtres humains d’avec le capital et l’Etat, et sans la remise en cause de l’ensemble des activités domesticatrices auxquelles ils participent encore avec complaisance. Tel n’est pas le cas, pour le moment du moins. Mais, sauf à choisir le suicide, tentons de vivre. Encore enveloppés par le monde du capital, nous pouvons cependant commencer à expérimenter aujourd’hui les façons de vivre et de transformer la nature qui nous conviennent, non pas à titre de modèles pour l’avenir, mais pour tenter d’échapper quelque peu à la survie actuelle, à l’empoisonnement de la planète par l’énergie. De là l’importance de la reprise, de la recherche et de la mise en œuvre de savoir-faire élémentaires qui, ne nous leurrons pas, relèvent encore en partie du palliatif, même lorsqu’ils dépassent le cadre des propositions environnementalistes officielles. Il en sera ainsi tant que le capital ne sera pas anéanti. Pour le combattre, nous sommes amenés à inventer des procédés qui n’auraient pas lieu d’être dans d’autres circonstances et à d’autres époques. Mais abandonner sous ce prétexte revient à renoncer à vivre. Mieux vaut, et de loin, tenter l’expérience.
[/ André Dréan.
Edition 2010 (première édition en 1994)./]
Pour toute correspondance : petervener@free.fr
 Non Fides - Base de données anarchistes
Non Fides - Base de données anarchistes