Accueil > Articles > Vieilleries > Souvenirs sur Libertad
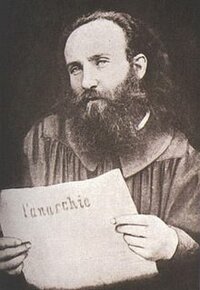
Souvenirs sur Libertad
Par Jane Morand (1923)
mardi 1er mars 2016
Notre courageuse camarade Jane Morand, qui fait actuellement à la Maison Centrale de Rennes la grève de la faim, nous adresse la lettre suivante :
Cher Colomer,
J’ai lu avec ravissement ton « Roman des Bandits  » dans la Revue n° 12.
Oui, tu as tracé un tableau magnifique de vie anarchiste dans la société et malgré la société, allant encore et se continuant dans le corps des survivants.
Inspiration grandiose et vibrante de vie et de vérité.
Je fus empoignée, à cause du sujet peut-être. Je te l’avoue, j’ai eu une immense -satisfaction de te voir exprimer aussi sainement notre cher Libertad.
Il fut si souvent entouré de si piètre façon, et de gens si mesquins parfois, lui si vaste, si vrai.
Je me suis sentie comme arrachée enfin aux étroitesses de Lorulot et consorts… Au moins toi tu as senti sa rude mais saine école. Tu as compris qu’il s’attaquait au superficiel qui nous hante et nous gouverne, à cet apparent conventionnel, conduisant l’homme à ne plus faire de tous les actes de sa vie qu’une passionnette formée de petits bouts rabibochés, réajustés d’une même et uniforme façon et pour tous. Et ce genre de mœurs conventionnellement préétablies nous situe en face de polichinelle bien plus qu’en face d’hommes de fond.
Libertad a travaillé sur les cœurs et les cerveaux par un ensemble de gestes accomplis par lui au milieu de nous et nous avec lui. Il fut un de ceux qui enseignent sans le paraître.
Si Libertad ne laissa rien derrière lui, comme je l’ai entendu dire par quelques négateur d’évidences, plus grincheux que sincères, c’est moins à lui qu’à notre sécheresse de cœur et d’esprit, à notre manque de générosité sincère et désintéressée, au sens le plus strict du mot ; c’est à notre stérilité morale qu il faut s’en prendre, c’est même à notre presque mauvaise foi.
Il nous dépassait tellement tous ! Ses vues étaient si profondes et si étendues et si simples en même temps que nous ne le comprenions pas, bien souvent. D’une générosité de cœur que pas un n’égalait, il allait, sans crainte ni pitié pour lui ni pour nos factices faiblesses, démolissant tous les arcs-boutants, étayant toutes nos formules de vie et que des grands hommes ou reconnus comme tels appuyaient de toutes leurs autorités.
C’était à ne plus savoir à quoi s’accrocher, c’était à ne plus savoir où poser le pied à cause de lui.
Derrière lui, il semblait que toute notre vie factice allait s’effondrer. Il ne voulait accepter et nous faire accepter que ce qui fut vrai, simplement vrai, tant dans la vie morale, sentimentale, que dans la vie physique. Il ne niait pas le sentiment, mais il voulait que celui-ci laissât la place, toute la place, franchement, sainement, à la vie physique.
Il nous entraînait à ne marcher que sur un terrain ferme et solidement logique, mais il nous fallait nier toutes les beautés conventionnelles formant la soi-disant richesse du monde civilisé.
Un terrain que lui sentait rigide sous son poids mais que nous ne savions pas toujours voir et encore moins sentir. Ce solide, ce vrai dont il nous parlait nous apparaissait bien parfois malgré nos âmes flottantes ou nos conceptions voilées, mais le plus souvent nous échappait totalement, redevenait alors pour nous comme inexistant parce que notre habitude du factice, du faux convenu, nous empêchait de voir, parce que l’habitude nous l’avait bien antérieurement fait oublier.
Il nous fallait avoir une bien ferme confiance en lui, mais ce n’était plus en rapport avec les enseignements du maître — comment ne pas avoir quand même confiance en lui que l’on sentait si purement vrai en tous ses actes ?
Après le doute venu, les spécifiques logiciens, mais aussi les plus étroits, lâchaient l’école. Ils avaient cessé de voir, de saisir l’exemple de la nouvelle vie ou, plus exactement, de la vie vraie de l’homme. Et c’est ce qui fait dire à quelques-uns que Libertad n’a rien laisse après lui.
Les sectaires, les moins dépourvus de cette petite vanité qui fait tout l’homme de nos jours ; les faiblards, toujours pris de vertige quand ils ne peuvent s’appuyer sur de vieilles traditions désuètes et vides de sens ; tous ceux-là et beaucoup d’autres encore préféraient nier ce grand négateur de toutes nos turpitudes sociales et nier aussi son travail, son œuvre, ce qui est pire. N’était-ce pas plus vite fait puisque l’on ne savait qu’opposer à son système d’assainissement encore et quand même.
— Où est son œuvre, me disait un jour un de ces coupeurs de cheveux en quatre ?
— Son œuvre est colossale, lui dis-je. Où elle est ? Mais dans la peur qui vous saisit au ventre dès que l’on vous parle de lui.
Tu le sais, il n’a pas seulement détruit la souveraineté du peuple, il a aussi détruit la souveraineté des papes, base de tout l’ordre social actuel, il a détruit toute institution qui n’ait une véritable force naturelle et scientifiquement vitale.
Du moins, s’il n’a détruit, son immense geste de vie nous a indiqué l’œuvre de destruction à accomplir.
Il nous a enseigné la puissance du vrai, du naturel, dans la parole et dans tous les gestes de la vie. Il a nié toutes les fantaisies des équilibristes mettant leur savoir, toute leur science, toute leur force à jongler avec des mots vides de sens, et laissant de côté LE GESTE, le seul qui compte pourtant.
C’est sur le geste résolu et raisonné, sur le geste qui embellit et amplifie l’être qu’il a voulu porter et qu’il a porté. Le geste, fondement et base de vie.
Sans le geste, point de vie, la vie c’est le geste ; mais que ce geste soit alors puissamment homme et non plus geste mièvre de polichinelles falsifiant la vie.
Plus de polichinellades ; des gestes humains, harmonieusement humains, puissamment et simplement humains.
Gestes de l’humain débarrassé de formules établies avant lui et non pour lui. Formules au cadre étroit qui assure une hiérarchie des hommes maîtres de l’homme.
Geste débarrassé des lâchetés sociales conduisant l’homme à faire des gestes de soumission, de bassesse et de fourberie d’une part, et des gestes hautains, grandiloquents et fourbes, d’autre part.
Gestes et formules conventionnellement faux n’ayant aucun rapport avec les gestes que nécessite la vie de l’homme. Gestes et formules niant l’homme, lui préférant le polichinelle, tuant ce que l’homme a d’humain en lui, de foncièrement digne pour n’en conserver que le factice voulu par l’état social, pour la conservation de la société autoritaire.
J’ai tenté, comme tu vois, d’élargir un peu ta définition trop succincte : « sage  ». Nos actuels esprits ont été tournés et retournés par tant de fausses conceptions, les mentalités ont été à ce point déformées par l’éducation chrétienne que le mot sage dit tout à la pensée ou bien peu.
Oui, je fus réjouie, charmée à la lecture de ta belle inspiration. Un tournant brusque, fatal peut-être, m’a pourtant heurtée.
Etait-ce pour rester dans la réalité du tableau ? pour mieux atteindre ton but : expliquer les bandits tragiques ?… C’est ce que je crois.
Après nous avoir esquissé la puissante joie de vivre que nous enseignait le Libertad pédagogue, tu ne nous montres plus que le plaisir de vivre de ceux qui le continuent, de ses enfants.
Ce diminutif le plaisir après la joie nous laisserait croire que c’est par dilettantisme et non par conviction profondément sentie que l’homme tente de réaliser sa vie d’anarchiste.
— « Ils ne voulaient pas plus être les bêtes de somme de la terre que les bêtes de reproduction de la race. Ne suivant d’autre loi que le rythme du pur plaisir, ils restaient en tous leurs gestes harmonieusement des joueurs.  »
— Certes, on ne peut enfanter comme de vulgaires bêtes subissant lourdement la loi aveugle de la nature que les lois grossièrement autoritaires et plus aveugles des hommes sont venues alourdir encore. Et tellement que l’individu se voit dans la nécessité de s’y soustraire presque totalement, au lieu de les respecter sciemment, ces lois naturelles et d’en jouir intensément, en homme vrai et en harmonie avec elles.
N’y a-t-il pas une joie puissante dans le désir de l’enfantement ? N’ajoute-t-elle pas encore à l’infini de la joie première que nous apporte l’amour ? N’est-elle pas cette joie de l’enfantement, l’amplification, le complément de la première qu’elle répercute à l’infini ?
Mais, pour consentir à cette joie finale et infinie, faut-il que toutes les circonstances nécessitant l’acte s’y trouvent réunies. Et c’est là où se trouve le tournant fatal.
La société broie l’homme. Avant même qu’il ait pu se réaliser dans sa toute première essence, il est déjà happé par le public ; ce moloch le guettant. Comment pourrait-il se permettre cette joie de se continuer en un autre lui-même ?
Et oui, c’est en se jouant que l’homme travaille le mieux. Le travail n’est et ne peut être qu’un libre jeu du corps et de l’esprit, un désir de se manifester, de s’extérioriser, de s’intensifier par les gestes jamais finis et qui forment toute la beauté de la vie.
— « …Mais en des gestes d’indifférente souplesse et de gracieuse force qui ne prenait rien de leur âme  » — mais qui prenait tout de leur corps et de leur esprit. La joie de se maintenir eux-mêmes ; de s’intensifier encore et quand même par la belle riposte à l’insulte de la police et qui a mis la peur au ventre des bourgeois, en nous prouvant à nous en même temps la force de l’homme sur les masses inconscientes bourgeoises ou non et sur l’ordre de choses établies, quand l’homme est bien décide à être et rester lui-même.
Jane MORAND.
P.S. : Une critique.
Pourquoi entretenir cette erreur que Libertad avait des béquilles ? Ne serait-il pas plus exact, tout au moins plus près de la vérité de dire qu’il avait des échasses ?
Parce que Libertad se servait de deux cannes solides pour marcher et qu’il manÅ“uvrait à bout de bras comme en se jouant. Ennemi du partisan du moindre effort, il n’eà »t pas consenti à balader bénévolement son corps dans le farniante de béquilles. D’ailleurs sa marche n’avait rien de l’effort coutumier du béquillard ; il marchait comme on valse. « Ce corps misérable  » — oses-tu ainsi parler de son corps ? A part ses jambes un peu fluettes et faibles, infirmité qui provenait de la paralysie infantile mal ou pas soignée, tout le corps était musclé et bien proportionné.
Et les beaux cheveux bruns, si fins, si soyeusement bouclés de mon tendre Libertad, ne sont que des épines à ta vue. A moins que tu aies voulu amener ton lecteur à faire une comparaison avec le Christ.
Si différent de conception de la majorité des hommes, on est encore amené comme malgré soi, en parlant de lui à conserver une façon railleuse, un peu ironique adoptée par beaucoup et je dirai même suggérée par lui. Il craignait peut-être que l’on tombât dans le travers bien digne des hommes faibles : en faire une sorte de Dieu.
C’est ainsi que lui-même se moquait, raillait quiconque voulait lui faire des salamalecs de politesse et des contorsions de prévenances. Jamais il ne se crà »t plus offensé que lorsqu’une délégation de socialistes de son quartier, je crois bien Charles Bernard en tête, était venue lui offrir une candidature de conseiller général dans le 18e arrondissement. Très sérieusement, il demanda à ces hommes quel mal il leur avait fait pour qu’ils se croient obligés de venir en nombre lui apporter pareil affront.
On a aussi ironisé sur lui parce qu’il était une énigme pour les vulgaires et c’est ainsi que l’on rit quand on ne comprend pas. Mais si pour éviter un travers qui dénaturerait on se met dans un autre qui ridiculise on n’y aura rien gagné. Chacun y mettant du sien, à la façon de Lorulot par exemple, on ne tient plus aucun compte des réalités. Et c’est ainsi qu’aux yeux de tous Libertad passe pour plus jeune qu’il n’était.
Libertad nous a quittés en 1908, le 12 novembre et il devait avoir ses 33 ans révolus le 21 du même mois. Il avait donc 33 ans moins 11 jours en partant et non pas 32. Aussi pour être exact, faudrait-il inscrire à côté de son nom : Albert Libertad 1875-1908.
J. M.
___
[Publié dans La Revue anarchiste, n°17, mai-juin 1923, pp. 14-16.]
 Non Fides - Base de données anarchistes
Non Fides - Base de données anarchistes